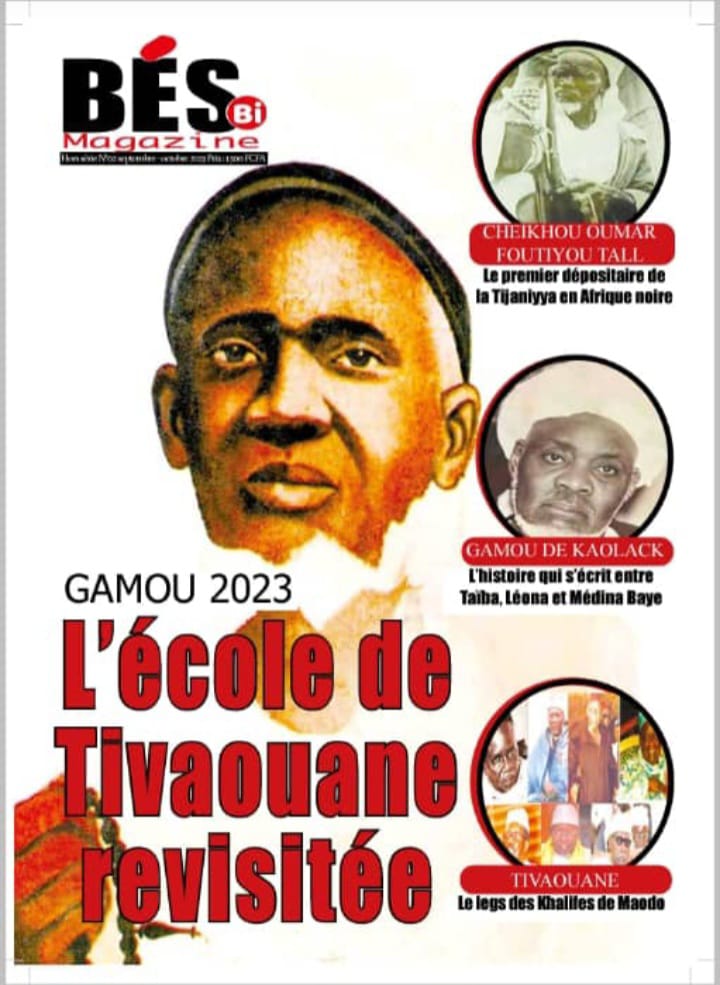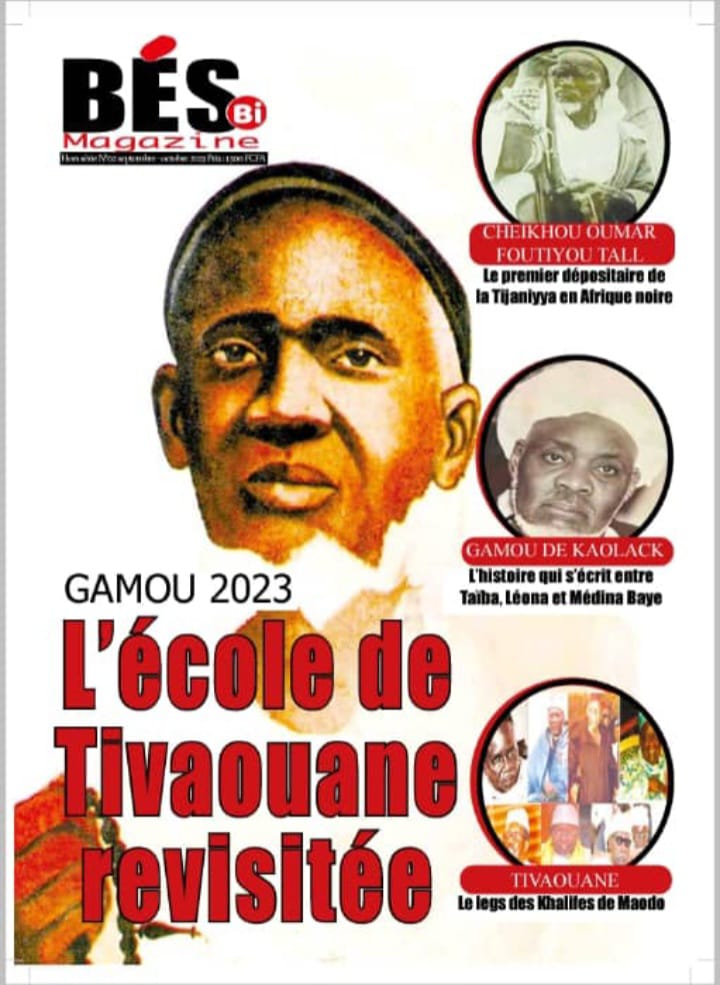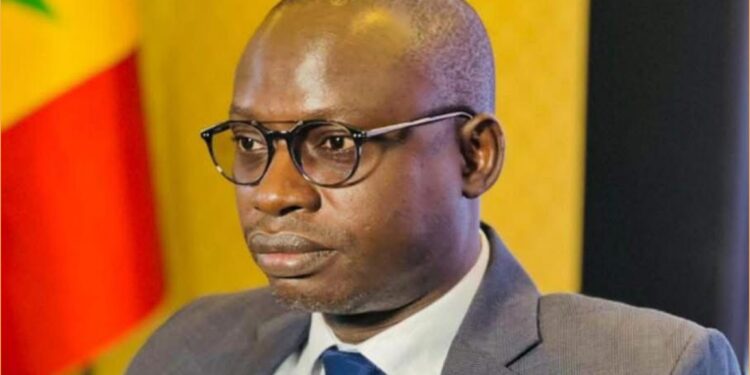Précision liminaire : j’avais prévu, dans un précédent post, de revenir sur les événements du Undo Mayo pour livrer mon analyse de la situation touristique en Casamance.
Merci de trouver, ci-après, le texte y relatif. Je reconnais qu’il est assez long.
1- Rappel des éléments contextuels
Le département d’Oussouye, particulièrement la commune de Diembering, a été, en 48 h, au centre de l’actualité régionale, voire nationale, suite à l’interdiction du Undo mayo, du nom de cette manifestation organisée le 1er mai, par le sous-préfet de l’arrondissement de Cabrousse.
L’événement qui en est à sa 16e édition polarise l’attention de presque toutes les couches de la population locale et mobilise, bien au-delà des limites départementales.
Undo Mayo, fête puisant ses origines en Guinée-Bissau voisine, traduit comme plusieurs formes d’expressions sociales et culturelles, une sorte de liant entre peuples transfrontaliers que l’hérésie coloniale a, vainement, tenté de saucissonner par l’absurdité des frontières.
Il est une opportunité d’affaires pour l’économie locale et une vitrine pour les artistes du terroir, dans une région qui a encore du mal à s’extirper des contraintes structurelles d’une économie touristique, fortement impactée par la crise sécuritaire et le faible volontarisme du pouvoir politique.
Son interdiction a été, d’autant plus, incomprise des organisateurs et des acteurs locaux que ces derniers ont, pendant plusieurs semaines, préparé ledit évènement, en mobilisant aussi bien des ressources financières que matérielles pour sa réussite. Il s’y ajoute que des réservations avaient déjà été faites, par des touristes ou simples visiteurs, au sein des réceptifs hôteliers pour l’hébergement, le temps de leur séjour.
Autant dire que le préjudice financier et matériel, voire moral, aurait été significatif, même si son évaluation n’a pas été faite de manière formelle.
Du reste, les motifs avancés par l’autorité administrative pour justifier la mesure d’interdiction ont été décriés, car ne convainquant pas les organisateurs et plusieurs acteurs locaux qui y voient plutôt la conséquence de manœuvres souterraines visant à saborder la notoriété de l’événement.
Au final, les concertations et le dialogue entrepris, entre les parties prenantes, ont abouti à la levée de la mesure d’interdiction et donc à la tenue de l’événement.
C’est le lieu de saluer la hauteur d’esprit et le sens de la conciliation des différents acteurs : autorités administratives, élus territoriaux, services de sécurité, comité d’organisation, chefs coutumiers et toutes les autres bonnes volontés qui, ouvertement ou discrètement, ont œuvré à la sortie de crise.
C’est le lieu aussi d’appeler les filles et fils du Kassa à plus d’union sacrée et de cohésion autour des problématiques communes qui nous interpellent dont le Undo Mayo, n’en est qu’une illustration partielle, en dépit de son acuité du moment.
C’est enfin, l’occasion d’inviter les uns et les autres à plus de circonspection dans l’appréciation que nous faisons des situations et des décisions qui sont prises par l’administration, à travers ses représentants.
Je suis persuadé que ce n’est pas de gaieté de cœur qu’une telle mesure a été prise par l’autorité administrative.
J’ai fait seize ans dans l’administration territoriale, gravissant, par la grâce de Dieu, les plus importants échelons de cet exaltant, mais tout aussi contraignant métier, parfois même ingrat.
Je sais, combien de fois, il est pénible et meurtrissant de se retrouver seul dans le silence et le secret de son bureau ou de ses appartements et de devoir prendre une décision, surtout quand sa mise en application doit produire des effets sur une partie de ses concitoyens.
Je sais aussi combien de fois, il est encore plus pénible et meurtrissant d’entendre, de lire, sans pouvoir y répondre, toutes sortes de récriminations, de jugements et même d’insultes des suites d’une mesure prise.
C’est pourquoi, quand on a la possibilité de tirer sur une cible sans défense, parce que tenue par la retenue et l’obligation de réserve, on doit le faire moins avec témérité, mais plutôt avec élégance, compte tenu de la disproportionnalité des postures du moment.
Je me dois aussi de préciser que mon intérêt pour cette affaire tient au tripe fait que je suis natif du Kassa, j’ai pratiqué aussi bien l’administration territoriale que centrale, ce qui m’a permis, sans prétention aucune, de prendre connaissance de plusieurs questions de développement d’intérêt national et enfin, comme tout citoyen, je suis en droit d’apporter mon avis sur la marche du pays, de surcroît de mon terroir.
2- Derrière la manifestation, mille équations
Ce rappel des éléments contextuels liés au Undo Mayo, n’est pas fait dans une logique synchronique. Il me sert plutôt de prétexte pour aborder, dans un spectre plus large et dans une perspective diachronique, une problématique plus globale : celle de la politique touristique et de ses contraintes structurelles, notamment en Casamance.
On s’accordera, dès le départ, qu’un post sur Facebook n’est pas le moyen discursif le plus approprié pour aborder globalement cette question, tant elle pourrait faire au minimum, l’objet d’un mémoire de master.
Ce n’est pas non plus un article fait dans la perspective d’une recherche. Il s’agit de générer des idées et de produire une réflexion sur une question d’intérêt.
Je m’en irai donc, directement, à ce que je considère comme essentiel.
Un bref regard rétrospectif, nous replonge dans l’effervescence touristique des années 80-90, avec les grands tours operators qui sillonnaient la Casamance.
On pouvait dénombrer des dizaines de bus, pleins de touristes admiratifs devant le paysage luxuriant et saisissant de la région, mais aussi devant la richesse culturelle et patrimoniale des terroirs.
De nombreux hôtels étaient implantés dans la zone, employant une main d’œuvre locale, pas suffisamment expérimentée.
En vérité, en dehors des taxes reversées à l’Etat, l’économie touristique était externalisée, bénéficiant beaucoup plus aux compagnies étrangères qu’aux populations locales.
Cette effervescence du secteur a connu un ralentissement, puis presque un coup d’arrêt du fait de l’insécurité engendrée par le conflit Casamançais.
En Basse-Casamance, deux faits majeurs ont, considérablement, impacté l’activité touristique.
D’abord, les attaques meurtrières des pêcheurs du Cap Skirring, en octobre 92, et de la Pointe Saint-Georges, en novembre de la même année, à quelques jours de l’ouverture de la saison touristique, ont semé panique et crainte, occasionnant, immédiatement, l’annulation de plusieurs vols touristiques. De sorte que le journal français Le Monde a pu titrer le 19 février 1993 « Les toubabs boudent Cap Skirring ».
Ensuite, « l’enlèvement » de touristes français, les couples Gagnaire et Cave, le 06 avril 1995, dans la zone du Parc national de Basse-Casamance.
Le regain de violence, dans la partie méridionale du pays, a créé une psychose et une peur généralisée, deux phénomènes qui sont répulsifs pour les investisseurs et les touristes.
Il s’y ajoute que les restrictions liées à la circulation des personnes et des biens faisaient qu’au-delà de 18h, le trafic interurbain était interrompu.
Les moins jeunes n’ont sans doute pas vécu ces événements, mais ceux de ma génération et au-delà savent bien de quoi il s’agit.
L’un dans l’autre, ces problèmes sécuritaires ont fortement infléchi la courbe de l’activité touristique au grand dam de la destination Casamance, plus particulièrement de la région de Ziguinchor.
Le basculement s’est naturellement fait au profit des zones plus calmes (la Petite Côte, le Delta du Saloum, Saint-Louis, Dakar et le Sénégal oriental, entre autres) qui, même si elles n’avaient pas les mêmes avantages comparatifs que le sud du pays, offraient au moins la quiétude et la tranquillité.
Dans la foulée, plusieurs réceptifs hôteliers ont mis la clé sous le paillasson, l’activité étant devenue économiquement peu rentable et socialement risquée.
Entre-temps, la situation sécuritaire a positivement évolué, notamment à partir des années 2000, à la faveur des efforts entrepris par l’Etat du Sénégal et les combattants du MFDC.
Mais, le spectre de l’insécurité a, toujours, plané et une réelle volonté politique, du moins pour le secteur du tourisme, n’a pas accompagné le processus de consolidation de la paix en Casamance.
Le changement d’approche a, sans doute, été observé avec la décision d’exonération fiscale en Casamance décidée par le Président Macky Sall.
Au niveau national, d’autres mesures ont été prises, parmi lesquelles la création du Crédit hôtelier et touristique en 2017, avec comme objectif de valoriser le potentiel touristique du pays, par le relèvement de la qualité du service et l’offre de produits adaptés au contexte économique, dans un secteur en perpétuelle évolution et compétition, et la suppression du visa d’entrée, après avoir constaté l’impertinence de son instauration.
Dans les faits, l’exonération fiscale n’a pas connu une application réelle en Casamance et les autres mesures de portée nationale tardent à produire les effets escomptés.
À titre illustratif, la région de Ziguinchor, c’est, en 2020, 139 réceptifs (tous standards confondus) dont 46% d’auberges, pour 3590 lits.
Au titre des nuitées, 368 074 ont été dénombrées dont 95% pour des touristes non-résidents, 4% pour les résidents sénégalais et 1% pour les résidents non-sénégalais (ANSD, SES, région Ziguinchor décembre 2023).
Ces chiffres, même s’ils interviennent dans le contexte du Covid 19, renseignent tout de même sur deux aspects majeurs de la situation touristique régionale : des infrastructures peu adaptées (presque la moitié est constituée d’auberges) et une plus grande prépondérance des visiteurs étrangers (95%) sur les nationaux.
Cela devrait questionner sur l’adaptation de l’offre touristique aux besoins et à la bourse des nationaux.
La situation est encore plus critique dans les deux autres régions de la Casamance que sont Sédhiou et Kolda.
Par ailleurs, le secteur ne saurait respirer pendant 5 à 6 mois (correspondant à la durée de la saison touristique) et étouffer, voire agoniser, le reste de l’année.
Il est tout aussi incompréhensible qu’il soit, pour le cas du Cap Skirring, à la remorque d’un seul établissement hôtelier, le Club Méditerranéen, pour ne pas le nommer.
Il est évident que dans ces conditions, on ne saurait parler de politique touristique assez structurée, surtout que les emplois générés et les externalités positives produites sur l’économie locale ne sont pas suffisamment documentés.
3- Sortir des sentiers battus, repenser notre offre touristique
Pendant près de quatre décennies, voire plus, l’offre touristique a été organisée autour du balnéaire, les touristes venant en Basse-Casamance pour profiter essentiellement du soleil, de la mer, du sable et des infrastructures hôtelières de détente.
D’ailleurs, des parties de la plage ont été même privatisées pour le confort et la quiétude des touristes.
Ailleurs, dans les régions de Sédhiou et de Kolda, c’est plutôt la chasse qui attire les touristes occidentaux.
Même si ces atouts naturels font partie des opportunités de notre région, il reste que la territorialisation de la politique touristique demeure encore marginale.
Celle-là, désignant le processus par lequel les politiques publiques (ici celle du tourisme) sont conçues, adaptées, mises en œuvre et évaluées en tenant compte des spécificités d’un territoire donné (géographie, population, ressources, dynamiques économiques, sociales, culturelles, etc.).
En d’autres termes, territorialiser, c’est décliner les orientations nationales en actions concrètes à l’échelle régionale, locale, en associant les acteurs territoriaux, en vue de répondre à leurs besoins réels et de renforcer la cohérence et l’efficacité de l’action publique à l’échelle locale.
Partant de là, et sans prétendre à l’exhaustivité, cinq (05) axes majeurs me paraissent prioritaires pour la relance du tourisme en Casamance.
Mais avant, il me semble qu’une vision, une orientation stratégique doivent guider l’approche. Elles pourraient se résumer comme suit : « faire de la Casamance une destination touristique de référence en Afrique de l’Ouest, fondée sur sa paix retrouvée, ses identités culturelles, sa biodiversité et son hospitalité légendaire ».
Les axes ci-dessous pourraient soutenir la politique touristique.
A- Valoriser durablement les ressources patrimoniales et naturelles
C’est une tautologie, un truisme que d’évoquer le riche patrimoine culturel et écologique de la Casamance. Son cosmopolitisme ethnique et son paysage kaléidoscopique en font une zone géographique et culturelle différente du reste du pays.
La valorisation de ce potentiel l’est toutefois moins, car la dimension économique de la culture et de l’environnement est pour l’instant faiblement exploitée.
L’objectif recherché ici, c’est de faire de la richesse patrimoniale, culturelle et naturelle de la Casamance, un levier structurant du tourisme. Cela implique une collaboration fonctionnelle entre les départements ministériels en charge de ces secteurs (culture, tourisme et environnement) pour procéder, par exemple, à l’inventaire participatif, au classement et à la protection des sites d’intérêt culturel et écologique.
Ce travail devrait permettre aux promoteurs touristiques et culturels de faire aux touristes des offres articulées autour de circuits thématiques : culturels (royaumes et villages traditionnels, sites et monuments historiques, lieux d’initiation etc.), écologiques (forêts, mangroves, bolongs, aires marines etc.) et religieux (lieux de culte historiques tels que l’église bretonne de Carabane, les mosquées séculaires de Karantaba et de Baghere, les lieux de recueillement et de pèlerinage etc.).
Un travail d’inventaire a, sans doute été fait par le ministère en charge de la culture. Des promoteurs, pris isolément, tentent, tant bien que mal, de proposer des circuits de visite.
Mais, l’articulation de toutes ces initiatives pour en faire une chaîne de valeur demeure marginale, comme en atteste, par exemple, la faible numérisation des informations sur l’ensemble de ces sites, ce qui aurait donné plus de visibilité et d’accessibilité.
B- Améliorer les infrastructures et l’accessibilité des circuits et sites touristiques
L’un des talons d’Achille de notre politique touristique réside dans la qualité encore moyenne de nos infrastructures.
Nous ne chercherons pas loin, en évoquant l’état de la route Ziguinchor-Oussouye-Cap Skirring ou encore l’aéroport de Ziguinchor dont les travaux prennent une durée inexplicable.
À cela, s’ajoutent les routes et pistes secondaires qui doivent mener aux différents sites d’intérêt touristique. Dans certaines zones ou localités, un transport multimodal (voiture, pirogue suivi d’un déplacement pédestre) est même nécessaire pour atteindre les lieux de visite.
Il convient, dès lors, de rendre fonctionnel l’aéroport de Ziguinchor, de mettre à niveau les infrastructures sus-citées, de désenclaver les sites à fort potentiel et d’améliorer les conditions de voyage ainsi que le confort des visiteurs.
Cela passe, tout évidement, par la réhabilitation, entre autres, des routes secondaires menant aux sites touristiques et par la dotation de moyens de transports fluviaux adaptés pour la navigation sur le fleuve Casamance et les différents plans d’eau de la région, constitués essentiellement de bolongs.
Il ne serait pas superflu d’harmoniser, à l’échelle régionale, la signalisation touristique pour avoir la même identité visuelle, ce qui faciliterait l’orientation des visiteurs.
Sur une autre échelle, l’aménagement de la station balnéaire du Cap Skirring est plus qu’urgente.
La restructuration et la mise aux normes de l’habitat, l’aménagement de la cité et la réalisation de la voirie et des réseaux divers, notamment d’assainissement, sont d’une acuité criante.
Qui n’a pas en mémoire le spectacle désolant des inondations touchant le centre de la localité et impactant même le trafic aérien ? Voilà une problématique majeure !
C- Positionner la Casamance à l’échelle nationale et sous-régionale
La région naturelle de la Casamance a une position géographique bien enviable.
Une frontière avec trois pays (Guinée-Bissau, Gambie et Guinée), des limites territoriales avec des zones éco-géograhiques à fort potentiel touristique (le Sénégal oriental avec le Parc national Niokolo Koba et tout le pays Bassari inscrit sur le patrimoine mondial de l’UNESCO et le Centre du pays qui abrite une partie du Delta du Saloum, également inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO).
La région dispose, en outre, d’une importante façade fluvio-maritime qui permet, en plus de l’activité de pêche, l’organisation de plusieurs excursions touristiques.
S’il y a, d’ailleurs, une question que je n’ai cessé de me poser c’est comment n’a-t-on pas su valoriser toute la façade maritime du côté de Diembering, du Cap et de Cabrousse, en dehors de l’activité de pêche et de baignade qui s’y pratique ?
Un port est implanté à Ziguinchor, en eaux fluviales, alors qu’à 70km de là, on dispose d’une façade maritime qui, autrement, aurait offert plus d’opportunités, tant pour l’activité de pêche, de transport, de fret ainsi que pour les sports nautiques et les activités de plaisance.
Il suffirait juste par des infrastructures routières, voire ferroviaires, de connecter cette zone au reste du pays et à la sous-région voisine pour en faire un pôle économique et un bassin d’emplois bénéfique au pays et à l’arrière-pays.
Le pouvoir actuel a annoncé l’implantation d’un port industriel à Gnikine dans le Diembering. Ce serait une belle avancée et une solution durable.
Le Plan Diomaye pour la Casamance, annoncé par le Premier ministre, serait aussi une opportunité de relance de l’activité économique.
En somme, le positionnement de la Casamance, à l’échelle nationale et sous-régionale, consiste à améliorer sa visibilité et son attractivité comme destination de référence au Sénégal et dans la sous-région ouest africaine.
Une première amorce de cette politique pourrait être de profiter de la position géographique de la région pour renforcer et structurer davantage les dynamiques touristiques entre la Casamance et les régions voisines (le Centre et le Sénégal oriental), mais aussi pour développer et promouvoir un tourisme ouvert sur la sous-région, par la création, par exemple, de circuits transfrontaliers avec la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée au regard des continuités culturelles et éco-géographiques qui existent entre ces territoires.
Une coopération entre villes frontalières desdits pays pourrait être un début, ce qui créerait ainsi des corridors touristiques reliant les différents sites d’intérêt.
D- Promouvoir un tourisme communautaire inclusif, équitable et durable et renforcer les capacités entrepreneuriales des acteurs locaux
Comme évoqué dans les lignes ci-dessus, les statistiques ont montré, en 2020, une plus forte présence des touristes étrangers (95%) que nationaux (4%) dans la région de Ziguinchor.
Cette situation révèle le déphasage entre l’offre touristique et les besoins ainsi que la bourse des nationaux.
Il convient de la corriger, car ma conviction est qu’on devrait œuvrer à une plus grande fréquentation de nos réceptifs par nos concitoyens.
Le sénégalais aime parler de ses vacances à l’étranger et ne peut, paradoxalement, vous citer les principales localités situées entre Dakar et Kédougou.
L’une des solutions serait, à mon avis, l’appui à la création, à la structuration et à la mise aux normes des campements et autres réceptifs de standing moyen pour la promotion du tourisme intérieur et de découverte.
On doit travailler à ce que le tourisme des nationaux, en plus de son impact économique, contribue à renforcer les expériences immersives de nos concitoyens au sein des communautés. C’est aussi un moyen de renforcer la cohésion nationale, par une meilleure connaissance de nos terroirs, de leurs communautés et du socle de notre unité nationale bâti sur l’acceptation de la diversité.
Dans le même temps, un soutien, sous forme d’allègement fiscal ou d’assouplissement des conditions d’accès au crédit, devrait être accordé aux entrepreneurs touristiques et culturels en vue de relever le niveau des investissements.
En outre, l’organisation de formations qualifiantes dans les métiers de guide culturel, de gestion hôtelière, de communication digitale, de restauration locale pourrait être faite aux profit des jeunes et des femmes pour leur permettre d’intégrer les chaînes de valeur touristiques.
La création d’incubateurs de projets touristiques, en relation avec les universités, les professionnels du métier et les collectivités territoriales pourrait y contribuer utilement.
Pour clore ce point, nous savons tous que le secteur touristique est tout aussi consommateur d’énergie, expansif (au sens d’occupation de l’espace) que générateur de déchets.
Nous devons veiller à ce que l’activité touristique ne crée pas un déséquilibre avec notre écosystème, en termes de pollution de l’environnement et de réduction de nos surfaces agricoles ou pastorales.
Des technologies appropriées de traitement des déchets devraient être utilisées, en relation avec les réceptifs hôteliers, car leur responsabilité environnementale est pleinement engagée dans ce domaine.
E- Relever le maillage sécuritaire au niveau des zones touristiques
L’insécurité ayant paralysé l’activité touristique pendant longtemps, la paix et la sécurité devraient être les moteurs de sa relance.
Dans ce sens, créer une marque et une identité territoriales fortes sont plus que nécessaires.
Longtemps dépeinte comme zone à risque sécuritaire, on devrait œuvrer à inverser cette perception pour parler dorénavant de « Casamance, terre de paix, de patrimoine et d’hospitalité ».
La consolidation de la paix implique aussi le relèvement du dispositif sécuritaire au niveau des sites touristiques pour lutter contre toutes les formes de délinquance, de trafic et de délits.
Telle est ma lecture et mon analyse subséquente de la situation touristique de la Casamance et des mesures à mettre en œuvre.
L’épisode du Undo Mayo, désormais derrière nous, n’est en fait que l’arbre qui cache la forêt.
À la baisse des rideaux et après avoir éteint les lampions, on devra, toujours, faire face à cette réalité implacable qu’est morosité touristique et économique.
Voilà, à mon avis, les questions qui devraient aussi, sinon beaucoup plus, mobiliser nos énergies et notre solidarité.
Agissons, solidairement et toute responsabilité, en relation avec les pouvoirs publics, pour que l’effervescence produite par cette manifestation ne cède, dès le lendemain au cri du désarroi.
Habib Léon NDIAYE