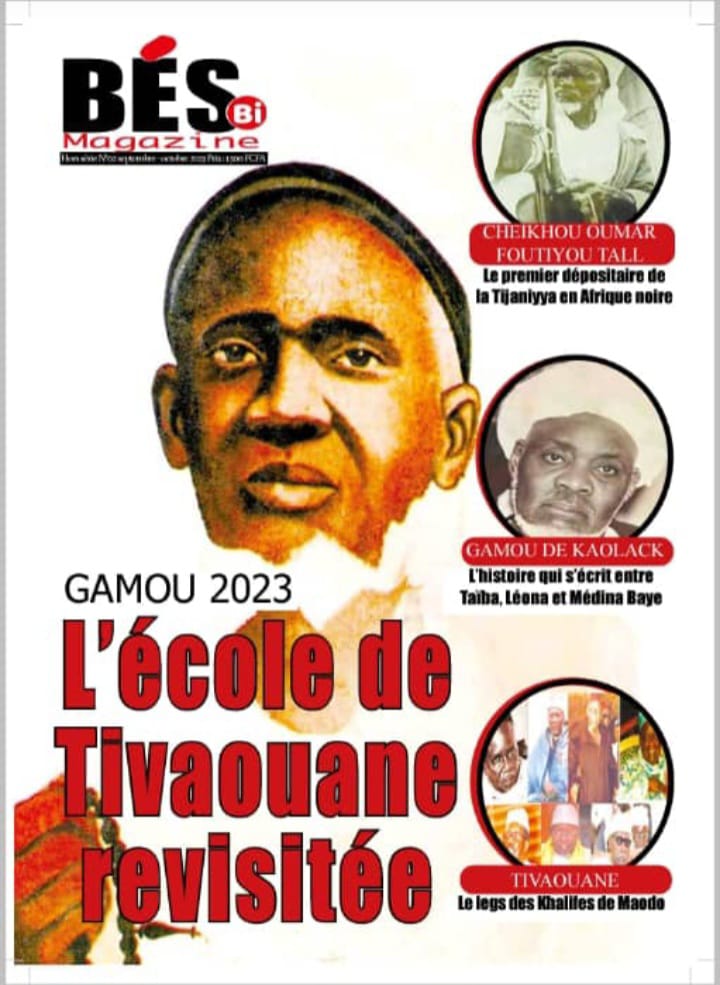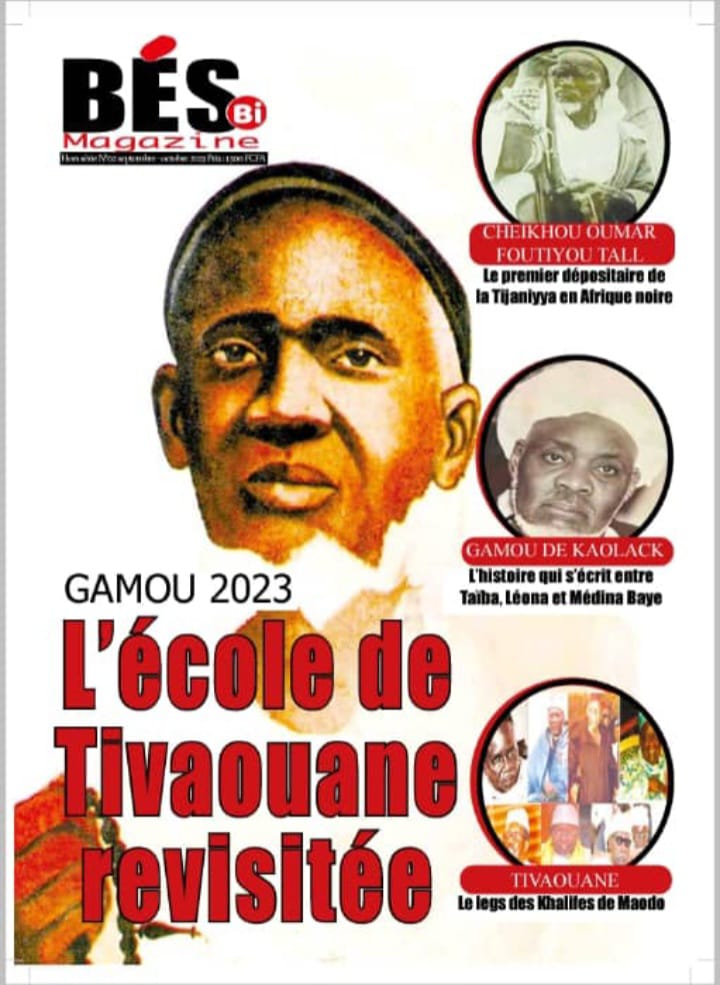La Guinée, un nain politique aux allures de géant économique en devenir ? Par ce paradoxe apparent, le pays se forge un destin de puissance malgré le sinueux chemin emprunté. Conakry, la capitale, change de visage à un rythme soutenu. La ville se caractérise par une effervescence immobilière elle-même synonyme de projection pour se doter d’infrastructures capables de répondre aux sollicitations en hausse constante.
Des hôtels surgissent de terre. L’éclairage illumine bien des artères mises en évidence comme preuves éclatantes d’un pays qui se transforme. Hommes d’affaires et experts « en tout » ainsi que des professionnels libéraux, prennent possession des lieux de rendez-vous mondains décorés avec soin et goût comme pour satisfaire les attentes d’une clientèle réputée exigeante.
Elle se montre discrète toutefois. Car la conjoncture politique reste quelque peu brumeuse avec la présidentielle prévue le 28 décembre prochain. La Cour Suprême a retenu neuf candidats en lice dont le général Mamadi Doumbouya arrivé au pouvoir par un coup d’Etat en 2021. Les principaux opposants, contraints à l’exil, en sont exclus de fait. Ce qui donne un aperçu des enjeux et des rapports de forces.
L’issue paraît certaine même s’il subsiste quelques aléas liés au taux de participation, à l’engouement des électeurs et surtout au score du vainqueur dont la figure se dessine déjà. La perspective rassure les investisseurs. Lesquels se montrent enthousiastes et signent des contrats « en veux-tu en voilà ». Quand bien même les forces de défense et de sécurité sillonnent rues et ruelles et s’en prennent presque à bras raccourcis à quelques adversaires téméraires et audacieux.
Quoiqu’il advienne à l’issue du scrutin, l’envol de la Guinée semble acté. Les projecteurs sont braqués sur ses mines dont la bauxite et le fer qui retrouvent ainsi des couleurs et des hauteurs sur des marchés en pleine expansion. Le pays se dote d’infrastructures de pointe à l’image du chemin de fer qui s’étend sur plus de sept cent kilomètres. Il transporte le métal vers un port qui n’est hélas pas en eaux profondes du fait de la faiblesse du tirant d’eau. Les risques d’échouage sont redoutés.
Qu’à cela ne tienne, la Guinée brandit très haut son mât ! Elle se vante d’une réjouissante perspective de la mise en œuvre de la mine de Simandou, inaugurée récemment en grande pompe. Le fer, qualifié de «caviar» par sa teneur, est fortement convoité. En volume, le site crache 120 millions de tonnes par an !
Les prévisionnistes s’attendent à un basculement de marché qui placerait la Guinée au centre de l’attractivité. A cet effet, la Chine s’est mise au-devant. Mieux, elle s’est donné les moyens de son ambition en diversifiant ses sources d’approvisionnement. Jusque-là, Pékin dépendait de l’Australie qui voit désormais d’un mauvais œil l’embellie guinéenne.
Politiquement, les deux pays entretenaient une relation délicate et sensible adossée à une géostratégie fluctuante au gré des intérêts et des positions. Le Brésil, l’autre géant du métal, est en embuscade.
Par cette « sécurisation stratégique », la Chine poursuit son ancrage en Afrique de l’Ouest et conforte son tracé de la route de la soie qui semblait au début s’écarter du continent. Très vite, les stratèges chinois ont rectifié le tir, erreur qu’ils ont gommée de leurs tablettes par un épais carnet de commandes.
L’Empire du Milieu respire donc avec l’ouverture et le démarrage de Simandou. Les Chinois ont patienté près de vingt ans, ne renonçant jamais à cette opportunité jugée exceptionnelle. Ce débouché désormais emballant, ajouté à une rectification de trajectoire de la bauxite place la Guinée en pôle position d’une émergence espérée. Si seulement les richesses en question pouvaient être soustraites à l’emprise de l’accaparement pour asseoir les bases véritables d’un décollage économique.
Les dirigeants guinéens semblent avoir la bonne lecture de la situation. Ils négocient ferme, l’œil rivé sur les indices boursiers. Ils concluent des accords avantageux. Ils se soucient certes des impacts d’exploitation et veillent un tant soit peu aux équilibres régionaux à partir d’une bonne tenue des sites miniers.
Bref le pays éclot ! Et projette de s’épanouir encore mieux si les ressources sont réparties à l’échelle d’une nation si fière de sa conquête d’indépendance et de son récit historique. Le prestige demeure. Mais l’influence piétine malgré les atouts dont dispose le « Château d’eau d’Afrique » ! Les nouvelles autorités en prennent conscience.
Elles rechignent toutefois à s’octroyer les moyens d’assumer un leadership à portée… de mains. Et pourtant Conakry s’ouvre au large. Du moins la diaspora guinéenne est reconnue pour sa vitalité et surtout son attachement au pays à travers de puissants réseaux de ramification. De l’extérieur, le retournement de conjoncture favorable à la Guinée n’est guère perceptible.
A l’évidence, les faibles signaux envoyés dénotent une méconnaissance des paramètres de déploiement. L’attitude frise une indifférence que rien n’explique a priori. En revanche, l’éclosion de la Guinée profiterait bien à la sous-région encore perçue comme une zone de conflits permanents et meurtriers sur fond de misère et de pauvreté affligeantes.
Nichée entre la Côte d’Ivoire au sud-est et le Sénégal au nord, la Guinée guette sûrement une occasion majeure de s’affirmer. Abidjan domine la sous-région et oriente son pilotage stratégique vers la région où trônent Accra et Abuja. Pour sa part, Dakar, marque le pas. Son économie, plombée par le renchérissement des facteurs de production, souffre d’une ambiguïté de situation.
Comment peut-on détenir des ressources en hydrocarbures et afficher un si faible niveau de compétitivité ! Les prix sont prohibitifs au Sénégal alors que partout ailleurs dans la région, les économies se diversifient et misent sur les avantages comparatifs.
L’imbrication des pays et la similarité des situations ont de quoi inciter les acteurs à « frapper ensemble » quitte à « marcher séparément… ». Le but du jeu, autrement dit l’objectif ultime, consiste à placer la région sur orbite pour sortir de son enfermement actuel. Il y a trop de politique et très peu d’économie le long des cours de saison. Plus rageant encore, la seconde subit assez souvent les errements de la première.
Sans aller jusqu’à la déconnection, l’inversion des rapports aurait pour avantage de laisser libre cours à l’imagination fertile des acteurs économiques. Cette liberté d’action ouvre, large, le champ des possibles dans bien des zones frappées d’ostracisme surtout et privées de commodités modernes : eaux, santé, routes, écoles, nourriture ou loisirs…
Les dirigeants africains manquent de vision d’ensemble et de profondeur pour une intégration horizontale des ressources. La configuration géologique de la région constitue un indicateur pour de nécessaires et impératives approches concertées. Autrement, compte non tenu des teneurs, le Burkina, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal pourraient individuellement céder leur fer à des prix différenciés. Les promesses actuelles d’achat ne seraient qu’un leurre à moyen terme.
Les grandes puissances rôdent autour du continent, objet d’une féroce et âpre convoitise. Ses dirigeants, eux, regardent ailleurs. Et restent sourds aux urgences… Alors que les investissements affluent. Mais ça, le FMI ne le dit pas ! Zut.
Par Mamadou NDIAYE