Au Sénégal, le Fonds monétaire international (FMI) a confirmé la présence d’une dette non comptabilisée de sept milliards de dollars entre 2019 et 2024 sous la présidence de Macky Sall. Une révélation qui fait écho à un rapport récent de la Cour des comptes et suscite de nombreuses interrogations sur la gestion budgétaire du pays.
L’économiste Yves Ekoué Amaïzo, président du think tank Afrocentricity, invité d’Afrique midi sur RFI, explique que cette situation résulte d’un déficit commercial chronique qui impacte la balance des paiements et déséquilibre le budget de l’État. Face à ce manque de liquidité, le gouvernement a sollicité des financements extérieurs, notamment auprès du FMI, dont les prêts sont assortis de conditions strictes.
Le processus de financement international suit un protocole rigoureux, avec plusieurs étapes avant l’approbation d’un prêt. Ces prêts exigent des garanties, qui ne se présentent pas sous forme d’hypothèques classiques, mais plutôt d’engagements sur les politiques économiques et les ressources stratégiques du pays. Ainsi, des recettes de l’État peuvent être affectées prioritairement au remboursement de la dette.
Toutefois, le FMI ne représente qu’une fraction de la dette globale du Sénégal, estimée entre 5 et 7 %. La majeure partie provient d’autres bailleurs internationaux, y compris des institutions bilatérales et des investisseurs privés regroupés au sein des clubs de Londres et de Paris. Ces partenaires renégocient régulièrement les termes des emprunts, en accord avec les autorités locales.
Concernant la notion de « dette cachée », Yves Ekoué Amaïzo nuance. Selon lui, le FMI n’a pas parlé de dissimulation, mais d’une information qui aurait été différée dans le temps. L’économiste illustre cette démarche par des pratiques comptables courantes : certaines dépenses peuvent être enregistrées dans des comptes de transfert et rééquilibrées plus tard.
Dans le cas du Sénégal, l’ancien gouvernement avait anticipé des rentrées financières issues de la production d’hydrocarbures pour compenser ces engagements. Cependant, des retards dans l’exploitation du gaz et du pétrole ont décalé ces prévisions, déséquilibrant temporairement les comptes publics.
L’arrivée d’un nouveau gouvernement de rupture a changé la donne. Une photographie budgétaire à un instant donné peut donner l’impression que certaines informations n’ont pas été enregistrées. Toutefois, le FMI, qui suit de près les finances des États, avait probablement connaissance de cette situation. Son objectif n’est pas d’intervenir politiquement, mais de garantir que les engagements financiers sont tenus.
Derrière cette question de dette, se pose également celle de la continuité des contrats liés aux ressources naturelles. Les investisseurs, qui avaient tablé sur des accords de long terme, s’attendent à leur maintien pour assurer la rentabilité de leurs engagements. Toute modification contractuelle pourrait redéfinir les prévisions de rentrées fiscales et compliquer davantage la situation budgétaire.
Ainsi, plus qu’une dette cachée, il s’agirait d’une gestion budgétaire basée sur des projections à moyen terme, dont l’équilibre a été perturbé par des retards dans l’exploitation des hydrocarbures et un changement de cap politique. Reste à savoir comment le nouveau gouvernement gérera ces engagements dans un contexte où les bailleurs internationaux surveillent de près la stabilité économique du pays.
Emedia

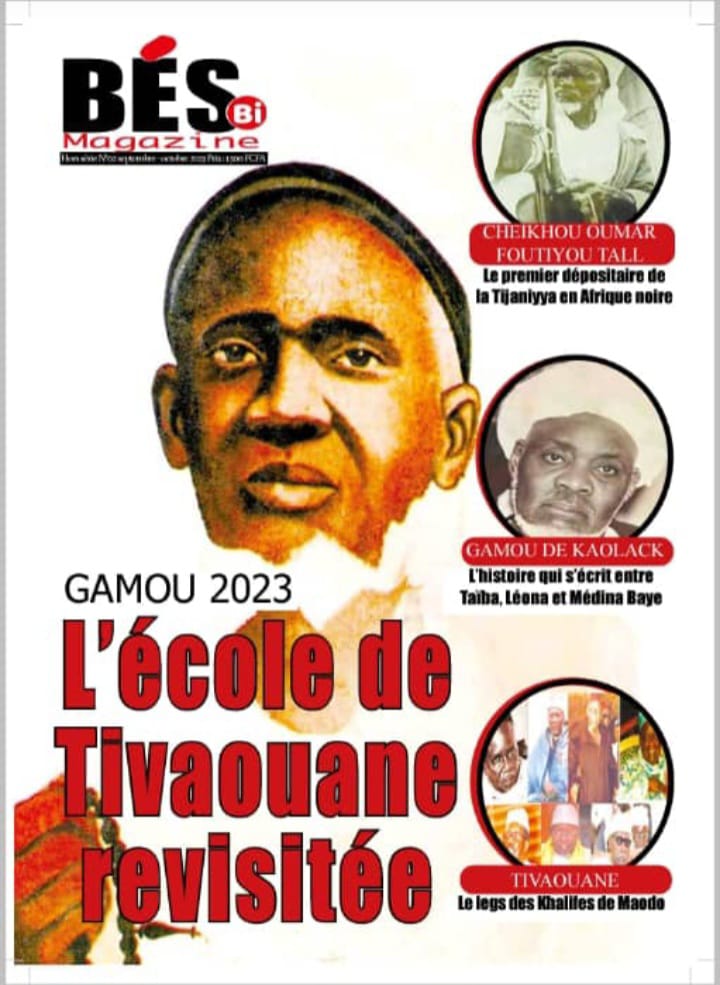
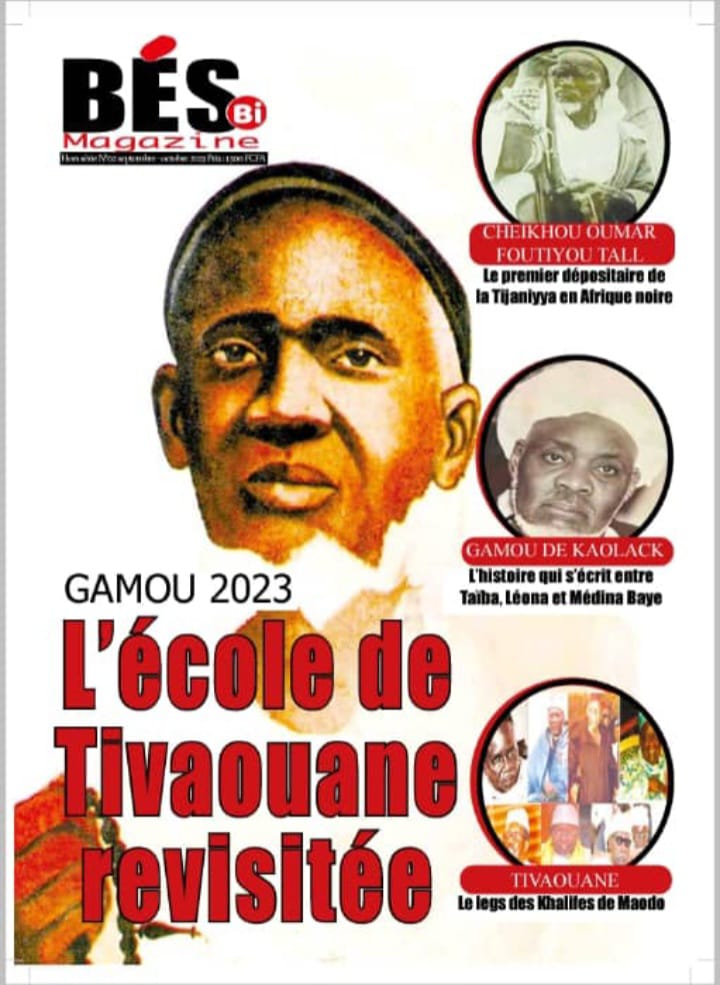










Rien que des mensonges. Ils nont meme pas hinte de sortir des idioties pareils. L’assemblee qui ordonne des lois na meme pas etait aux courant des 4500 milliards de dettes contractes par l’etat.