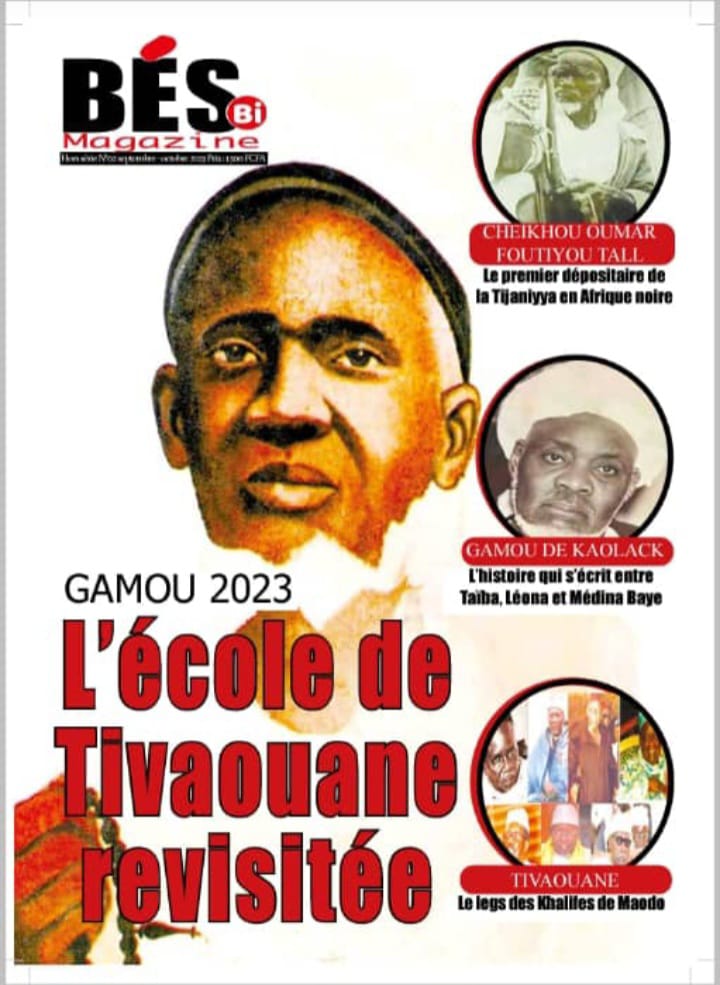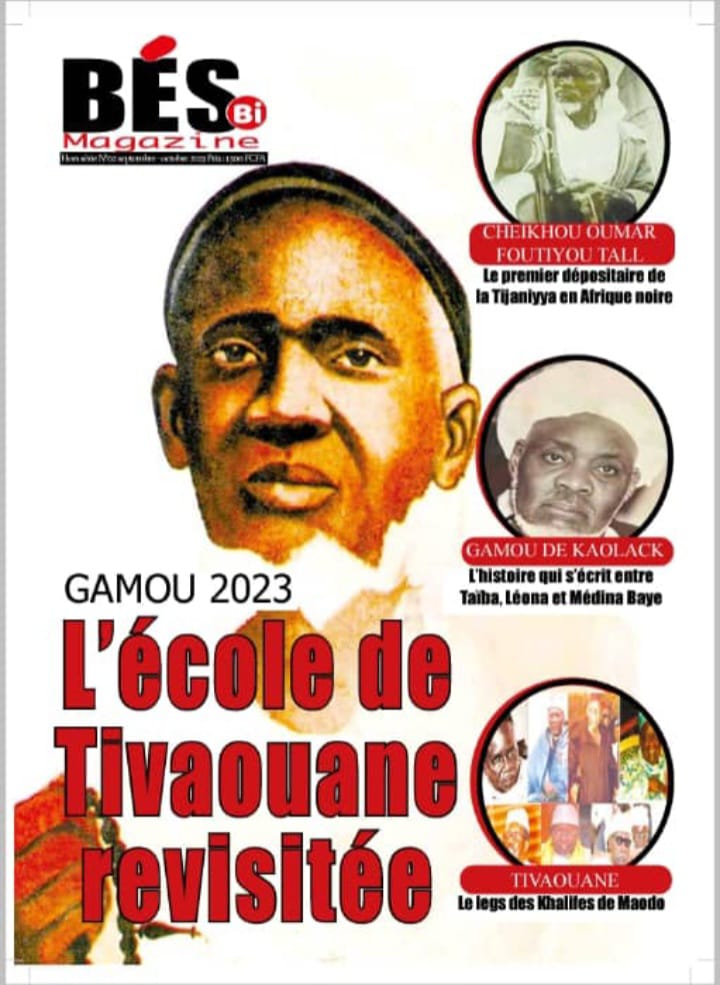Au Sénégal, comme dans de nombreux pays en développement, l’enrichissement suspect de certains fonctionnaires est devenu un phénomène aussi banal qu’inquiétant. Il s’installe dans les mentalités, se normalise dans les pratiques, et fragilise chaque jour davantage la confiance entre l’État et les citoyens. Le service public, censé être l’incarnation de la rigueur, de l’intégrité et de la loyauté envers la République, devient parfois un terrain fertile pour l’enrichissement personnel.
Hier, le Premier ministre Ousmane Sonko a brisé le silence sur cette question sensible. « On ne peut pas devenir milliardaire en étant fonctionnaire. Pourtant, ce phénomène s’est banalisé », a-t-il lancé lors d’une rencontre sur la réforme de l’administration. Une phrase forte qui résonne avec le ressenti d’une large partie de la population, confrontée à une administration souvent perçue comme opaque, inégalitaire, voire corrompue.
Ce fléau n’est pas uniquement moral. Il a des conséquences directes sur l’économie et le fonctionnement de l’État. Lorsqu’un agent détourne des fonds ou obtient illégalement des avantages, ce sont des services publics qui en pâtissent : des routes non construites, des hôpitaux sous-équipés, des écoles délaissées. La corruption bureaucratique est un impôt invisible, payé chaque jour par les citoyens les plus modestes.
Au Sénégal, les exemples d’enrichissement injustifié ne manquent pas, mais les condamnations restent rares. L’écart entre les salaires officiels et les signes extérieurs de richesse est parfois choquant. Des fonctionnaires affichent un train de vie déconnecté de leurs revenus déclarés, sans que cela n’éveille de réelles enquêtes administratives ou judiciaires. Certains directeurs généraux gagneraient jusqu’à quatre fois plus que le président de la République lui-même, selon Sonko.
Ce déséquilibre nourrit un climat de frustration et de défiance. Il pousse parfois d’autres agents à céder à la tentation, dans une spirale de justification sociale : « tout le monde le fait ». Cette banalisation du détournement affaiblit les fondements mêmes de l’État de droit et bloque toute tentative de réforme en profondeur.
Face à cette situation, des voix s’élèvent pour appeler à une véritable moralisation de la vie publique. Des lois sur la transparence, la déclaration de patrimoine et la protection des lanceurs d’alerte sont en discussion, mais peinent à produire des effets concrets sans volonté politique ferme ni mécanismes de contrôle indépendants et crédibles.
Lutter contre l’enrichissement illicite, c’est protéger l’État. C’est garantir que les ressources publiques servent l’intérêt général, et non des ambitions privées. C’est aussi rappeler que le service de l’État est une mission, pas une opportunité d’enrichissement personnel. Si cette ligne morale n’est pas retrouvée, aucune réforme structurelle ne pourra porter ses fruits.
Emedia